Le site |
Les mises à jour |
Le livre d'or |
L'amicale |
Adhésion |
Nous contacter |
Courrier des anciens |
Littérature |
Zone réservée aux membres :
Les membres |
Histoire |
Conception, réalisation et animation : Eddy Tomczyk
Conseiller artistique : Yvan Burda
Webmaster : Pascal Barge
Version : 1.2 - Nov 2009
Chapitre I
Le Traité de Versailles
La première occupation de la Rhénanie
La ville de Neustadt an der Haardt
Rappel Historique
L’occupation de la Rhénanie débuta par une opération militaire.
Elle visait à empêcher les forces allemandes de revenir dans la région proche de la France ou de reprendre tout simplement la guerre.
Il s’en est donc suivi l'occupation de la rive gauche du Rhin, avec des têtes de pont, françaises à Mayence et à Kehl, américaine à Coblence et britannique à Cologne.
Concernant la France, cette opération fut menée par le Groupe d'Armées (G.A.F.) du général FAYOLLE , comprenant les VIIIe et Xe Armées, commandées respectivement par les généraux GÉRARD et MANGIN.
Ce G.A.F. était une force très offensive, avec 7 CA, soit 18 divisions d’infanterie et 2 divisions de cavalerie. Toutefois les troupes françaises sortaient de la Grande Guerre affaiblies et épuisées.
Cet état d’Armistice, signé le 11 novembre 1918, rendait possible la reprise des opérations de guerre à tout moment, en raison de l’attitude des responsables du gouvernement allemand et du climat d’insécurité régnant dans diverses régions d’Allemagne.
En même temps que les premières troupes françaises franchissaient la frontière avec l’Allemagne, les états-majors français achevaient des plans concernant la réduction des effectifs, parce qu’aucun commandement ne pouvait garder autant de soldats dans ses rangs.
Dans les premiers mois de 1919 est donc apparue une démobilisation massive pour relever l'économie française et stabiliser la situation avant la signature du Traité de Paix quelques mois plus tard.
La France devait conserver néanmoins sur le Rhin les effectifs et les moyens nécessaires pour mener une action au cœur de l’Allemagne, voire jusqu’à Berlin. Les Américains, pour leur part, furent pressés de rapatrier leurs contingents et les Britanniques soucieux de réduire les leurs au minimum indispensable.
Le territoire allemand de Rhénanie ou le pays rhénan à occuper sur la rive ouest du Rhin fut alors divisé en quatre zones respectivement du Nord au Sud (de la région de Düsseldorf à Lauterbourg), par les Belges, les Britanniques, les Américains et les Français.
Du côté français, le dispositif de la garde au Rhin, incluait un secteur nord, tenu par la Xe Armée avec PC à Mayence et un secteur sud, tenu par la VIIIe Armée avec PC à Landau, dont le 1er CA Colonial et son PC à Neustadt.
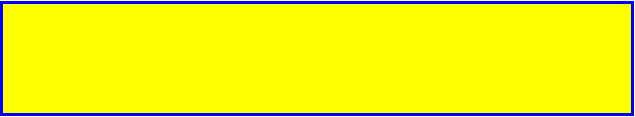
A noter toutefois que le Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, entraîna, dans les mois suivants, la dissolution du G.A.F. et de ses deux armées en donnant lieu à la création de l'Armée Française du Rhin (AFR), réduite à 3 CA. Cette troupe d'occupation en Allemagne se mit en place doucement et il est loisible de penser qu'elle était vraiment dans sa zone à la fin de 1919 ou au début de 1920.
Ce pays rhénan fut toujours convoité à travers les âges. La période la plus marquante, celle qui laissa de profondes cicatrices dans la région parmi les chercheurs et les universitaires allemands, fut incontestablement la guerre de Trente Ans sous LOUIS XIV. Le maréchal TURENNE fut abondamment cité dans les ouvrages, dont les derniers articles lui étaient défavorables. Ensuite la culture que la France mit en place au XXe siècle fit honorablement parler d’elle en Allemagne, car le Rhin, cet imposant fleuve paisible et facilement traversé, fut toujours considéré comme une frontière naturelle et ce malgré l’influence prussienne après 1815. Si nos grands stratèges n’envisagèrent pas la menace germanique au-delà de ce Rhin, le réveil fut brutal en 1870 et encore plus en 1914. Ce que le général FOCH comprit très vite. Ses ordres allèrent d’ailleurs dans ce sens après la capitulation allemande de 1918.
A ses subordonnés, il donna les directives suivantes : « En face de la répugnance allemande à signer les Préliminaires de Paix, il faut briser la résistance là où elle réside, c’est-à-dire Weimar et Berlin, avec des moyens militaires indiscutablement supérieurs ». En outre, FOCH avait toute latitude pour imposer son choix car il était le commandant en chef interallié et disposait à ce titre de toutes les prérogatives sur les troupes américaines, anglaises, belges et bien entendu françaises pour asseoir son autorité. C’était le grand chef. Georges CLEMENCEAU en tant que Président du Conseil lui apporta tout son soutien.
A partir du Traité de Versailles la Haute Commission Interalliée des Territoires Rhénans occupés (HCITR), dirigée par Paul TIRARD, organisme civil dont le siège était à Coblence, décida de l’avenir du pays rhénan. Son rôle fut de veiller à la stricte application des clauses du Traité, de surveiller les relations entre le pouvoir civil allemand et les armées d’occupation et d’assurer le maintien de l’ordre tout en maintenant la sécurité des troupes.
Cette commission pouvait donc émettre toutes les ordonnances de la police, de la presse, des voies de communication et les lois et règlements allemands lui furent soumis pour approbation.
Les relations entre occupants et occupés furent délicates. Il y avait ce système de réquisition qui perturbait irrémédiablement la population autochtone car elle devait se serrer dans toutes les surfaces non sollicitées et supporter des privations de tout ordre. Au départ définitif des armées en juin 1930, des opérations de représailles eurent lieu non seulement contre les mouvements séparatistes allemands mais aussi à l’encontre de toutes les personnes suspectées de connivence avec les troupes d’occupation.
Immédiatement après l’Armistice
C’est en vertu des textes d’Armistice que s’accomplit officiellement du 1er au 17 décembre 1918, dans une situation générale allemande très confuse, l’occupation de ces territoires de Rhénanie et les états-majors d’armées interalliées s’installèrent dans les grandes villes de Cologne, Coblence et Mayence, points de passage obligés sur le Rhin afin d’établir leurs têtes de pont, en ajoutant des « poches » de 30 km de rayon au-delà du Rhin, sur sa rive droite.
La progression des Armées Alliées commença le 1er décembre 1918 et s’acheva par l’occupation de la tête de pont de Kehl des troupes françaises, le 4 février 1919.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
L’arrivée des troupes françaises à Neustadt - 1er CAC
Le 1er Corps d'Armée Colonial (qui était aussi l’état-major d’une Région Militaire), avec à sa tête le général MAZILLIER, était l’une des grosses unités à avoir pénétré en Allemagne, juste après l'Armistice, dès le 19 novembre 1918. Il installa son état-major dans la ville de Neustadt en réquisitionnant un imposant bâtiment construit en 1909 . Situé au fond et sur le côté gauche de la Luitpoldstraße en allant vers la ville, ce bâtiment convenait fort bien au commandement français de l’époque. Il avait été devancé par un détachement précurseur composé de quelques officiers français qui fut reçu par le premier élu de la ville avant de les escorter vers les baraquements d’un ancien bataillon d’assaut du territoire, en direction du bourg de Mussbach au Nord-Est.
Très rapidement le bureau de la place fut ouvert.
Mais il fallut héberger les premiers 260 militaires. Le gymnase municipal fut trouvé et aménagé. Quelques locaux occupés préalablement par des militaires du Kaiser, furent repris.
Dans les mêmes délais le mess des officiers fut installé en ville, avec pignon sur rue.
A ce stade de la lecture, précisons que le village uni de Lachen/Speyerdorf ne faisait pas partie de la garnison de Neustadt autrefois.
Le commandant civil de la garnison de Neustadt, le major TESTARD, arriva aussi parmi les premiers, le 9 décembre 1918, et réquisitionna la villa Abresch, à proximité du centre ville. Le drapeau tricolore français flotta désormais sur l’hôtel de ville de Neustadt.
La ville de Neustadt compta en ce temps là environ 20 000 habitants et dépendit de la Couronne de la Bavière . Elle était toute petite et la partie principale se limita à la Hauptstraße avec en bas ses deux églises, dont l’une au double clocher, et la gare centrale en haut, à l’autre bout.
Par exemple, la rue Luitpold ou plus exactement Konrad ADENAUER à partir de 1967, bien connu des résidents contemporains de la cité Maison de France, s’arrêta à hauteur du cinéma ROXY soit 400 mètres sur la droite et le reste n’était qu’une piste.
Il y avait certes quelques autres petites rues adjacentes, cependant aucune comparaison n’est possible avec ce que les premiers Français trouvèrent en 1945, encore moins avec l’étendue de la ville vers la fin du XXe siècle.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Dans les mois qui précédèrent la signature du Traité de Paix en juin 1919, un premier dispositif français, décidé à la hâte, alla connaître des fluctuations importantes, en raison des directives du Maréchal Commandant en Chef . Elles précisèrent :
- maintenir constant le potentiel des troupes susceptibles de contraindre les responsables allemands à respecter les clauses de l’Armistice,
- reconstituer les grandes unités dissociées au cours des opérations de la Grande Guerre,
- ramener dans leurs garnisons de l’Intérieur (France Métropolitaine) les Grandes Unités organiques des CA,
- procéder à la dissolution des GU rendue nécessaire par la libération des classes de l’armée territoriale,
- relever certaines garnisons américaines dont les effectifs étaient en cours de rapatriement vers les Etats-Unis d’Amérique,
- ne conserver à l’Armée du Rhin que les Grandes Unités (GU) indispensables.
En fonction de ces dernières directives, on nota, entre février et avril 1919, l’arrivée progressive de France du 32ème CA qui remplaça le 1er CAC en ville. Les troupes françaises libérèrent les derniers prisonniers des camps environnants ou ceux vivants au milieu de la population.
(C’est ainsi que l’on apprit que des femmes allemandes furent condamnées à de la prison ferme - entre 2 et 5 mois - pour avoir partagé une certaine intimité avec un prisonnier français).
Toute la partie ouest du fleuve Rhin fut totalement démilitarisée et les soldats allemands disposèrent de 14 jours, après la signature de l’Armistice, pour permettre aux Alliés de disposer de toute leur zone. Le retrait des troupes allemandes s’effectua en ordre et avec beaucoup de discipline. Il y eut d’abord de longues colonnes d’attelages hippomobiles, puis des colonnes de soldats à pied. L’aviation française, sans cesse, survola les troupes pour enregistrer tous les mouvements et s’assurer de l’application scrupuleuse des conditions de l’Armistice.
Cependant l’avant-garde des troupes françaises nota les réticences allemandes qui se manifestèrent çà et là et ne furent pas d’un bon présage. C’est dans cet esprit de résistance allemande que les 600/700 soldats français jetèrent un blocage quasi complet sur la ville. Le 13 décembre 1918, le général GÉRARD, commandant en chef la VIIIe Armée Française avec son PC à Landau, dont dépendait les troupes stationnées en ville, vint présenter les plans d’occupation de la garnison aux autorités civiles.
Mais Neustadt ne fut malheureusement pas préparée à l’arrivée massive des troupes françaises et la population dut abandonner certaines infrastructures publiques au profit de ces forces, notamment les salles des écoles. Tout cela ne suffit pas et il fallut recourir à la réquisition d’autres propriétés privées. Dans la précipitation, les élus de la ville durent faire face aux multiples requêtes de l’occupant, mais toujours avec une circonspection caractérisée. Certaines grandes industries quittèrent même la ville ne souhaitant pas être au contact de l’occupant français.
Le couvre-feu et la censure
Les militaires français imprimèrent leur volonté et très rapidement, les postes et télégraphes connurent quelques dysfonctionnements. Un couvre-feu total confina la population dans les demeures. La Polizei dût accepter les exigences de l’occupant par son maintien en alerte permanente, la gare fut bloquée, la censure intervint dans les journaux locaux et des postes de contrôle (identité, douanier et économique) furent mis en place dans toute la zone. Seuls des journaux français étaient disponibles dans les kiosques du centre ville.
La culture
Les troupes furent à peine installées un peu partout en cette année 1919 que les activités culturelles occupèrent déjà l’esprit du commandement. Outre le fait qu’il souhaita inculquer rapidement la langue française, il fallut en contrepartie égayer tout le monde . Ainsi un groupe théâtral français donna une représentation des pièces de MOLIERE dans la grande salle de la Saalbau , dans le centre ville. C’était un peu un exercice pratique pour les adultes qui suivirent les cours de langue. Au programme il y eut les Femmes savantes, le Misanthrope, le Médecin malgré lui, Tartuffe, etc. L’accès était réservé, en priorité, aux citoyens français, cependant il devint possible aux ressortissants civils allemands d’assister aux représentations. Il y eut aussi des galas comme ceux donnés par l’orchestre symphonique du groupe d’armées FAYOLLE.
L’articulation des troupes
Le dispositif militaire français, en date du 27 janvier 1919, qui représenta une large ellipse avec sur sa droite le Rhin, s’étala du nord de Düsseldorf, le long de la frontière avec la Belgique, puis la France pour descendre au Sud jusqu’à Lauterbourg et Karlsruhe.
Dans la région, autour de Neustadt, il y eut le Groupe d’Armées Françaises du général FAYOLLE avec PC à Kaiserslautern. Il commanda 2 armées :
- La VIIIe Armée du général GÉRARD à Landau qui elle-même comprit 2 corps d’armées :
. La 1ère Division d’Infanterie Marocaine (1ère DIM), PC à Ludwigshafen,
. La 2ème Division d’Infanterie Coloniale (2ème DIC) dans la région de Bad Dürkheim, qui fut remplacée par la 5ème Division d’Infanterie (5ème DI) à la mi-février 1919,
. La 3ème Division d’Infanterie Coloniale (3ème DIC), PC à Speyer (Spire).
- Le 2ème Corps d’Armée (2ème CA), PC à Edenkoben.
- La Xe Armée du général MANGIN à Mayence.
Ce dispositif resta figé jusqu’au début 1920 et laissa ensuite la place à une première réorganisation en profondeur (que l’on appela aussi second dispositif).
Afin de stimuler ses troupes, le général GÉRARD publia l’Arrêté n° 387 en date du 28 novembre 1918 :
« La Victoire a couronné votre Héroïsme. Vous allez occuper un sol sur lequel il y a un peu plus d’un siècle, nos grands ancêtres firent flotter nos trois couleurs. Vous continuerez leur œuvre : vainqueurs vous forcerez l’estime et le respect de ce pays comme vous avez forcé l’admiration de l’Univers. Le triomphe vous impose des devoirs ; magnanimes en votre gloire, vous les remplirez sans haine comme sans faiblesse. A la rage dévastatrice du barbare, vous opposerez la ferme et sage équité de notre race libératrice ; à un peuple courbé sous une tyrannie centenaire, vous montrerez ce que peut et ce que veut une nation libre, consciente de sa puissance et de sa loyauté : et, contrairement au système qu’a renié la civilisation, vous n’attenterez ni à la sécurité ni à la propriété d’autrui. Vous serez pour le Monde, autant par votre esprit de discipline que par votre vaillance, l’exemple et la leçon. La France républicaine ne resplendit pas seulement par son courage ; elle est, elle restera dans l’Histoire l’éternelle Patrie du Droit ».
Toutes ces grandes unités françaises, encore durement éprouvées par les rudes combats de la Grande Guerre, virent leurs effectifs fondre comme neige au soleil.
Si les numéros des unités furent maintenus, en revanche le compte en hommes n’y était pas. De grandes unités divisionnaires n’eurent plus suffisamment d’officiers pour tenir tous les postes. Et plus l’échelle de la hiérarchie descendit vers les unités subordonnées, plus il fut incontestable de remarquer le manque en moyens humains. En outre, la démobilisation battit son plein.
Dans un quadrilatère délimité par une ligne Kaiserslautern – Bad Dürkheim, Ludwigshafen au Nord, puis à l’Est le Rhin jusqu’à hauteur de Karlsruhe et Lauterbourg, il y eut les Quartiers Généraux des unités citées ci-dessus, mais aussi les PC de la 4ème Division d’Infanterie, une Division de Cavalerie à Cheval et une Division de Cavalerie à Pied, sans parler des unités de légionnaires.
Pour ce qui concerne la ville de Neustadt, les effectifs globaux, au plus fort de leurs présences, dépassèrent rarement le millier d’hommes, officiers et hommes de troupe compris. (Il est probable, même si les archives ne le dévoilent pas clairement, que les régiments, fortement amputés, effectuèrent des séjours de deux ans environ en Allemagne, coupés par des périodes identiques en France).
Au cours de cette période, le 12ème Régiment d’Aviation de Bombardement s’installa à Lachen/Speyerdorf, dans sa partie est, remplaçant le 3ème Régiment de Bombardement de Jour qui fut le premier locataire de cette partie du terrain.
Si ces hommes de troupe eurent souvent recours à la tente au début ou à quelques lieux durs mais vétustes des environs pour établir leur campement, les officiers, quant à eux, réquisitionnèrent et occupèrent de somptueux appartements en ville.
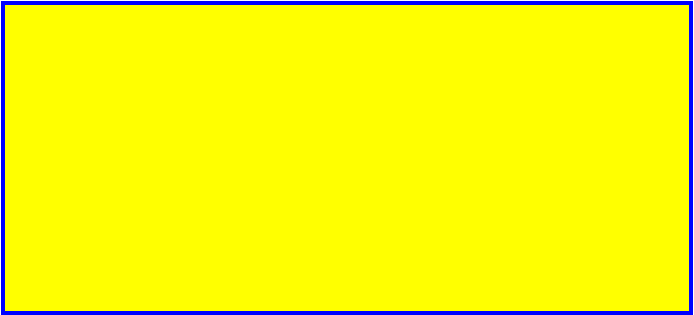
Le reste du Reich regarda la partie gauche du Rhin comme une profonde plaie et la preuve irréfutable de la défaite des armées du Kaiser. On considéra la conférence de la paix de Versailles du 18 janvier 1919 aussi ténébreuse que les conséquences de la révolution bavaroise.
Toutefois, en Rhénanie les premiers mouvements « séparatistes » ou plus exactement « autonomistes » apparurent et le commandement militaire français, en contradiction totale avec les ordres parisiens et alliés, favorisa cette nouvelle orientation*.
Le 1er juin 1919, le ministre-président de Bavière, Johannes HOFFMANN, nouvellement élu depuis quelques mois, proclama à Spire la République du Palatinat. A la même date le général GÉRARD, promu, prit le commandement des troupes françaises à Mayence et affirma qu’il ne soutiendrait pas par les armes un putsch favorable au mouvement séparatiste rhénan.
Alors le peuple allemand rhénan et ses politiciens s’en prirent à sa personne.
* Ce fut l’œuvre du général MANGIN.
Départ du 1er CAC et arrivée du 32ème CA à Neustadt
Avant la ratification du Traité de Versailles, le départ définitif du 1er CAC de Neustadt pour la métropole fut différé de quelques semaines en raison de l’attitude allemande qui ne mettait point d’enthousiasme (cette situation s’empira avec le temps devenant une réelle opposition) à exécuter les termes de l’Armistice. La région fut une source de préoccupation constante pour le commandement français local, soucieux de préserver les intérêts de la France et d’apporter au peuple allemand la liberté tout en assurant la primauté du droit et de la justice. De nombreuses actions mirent à mal le moral des troupes françaises (barrages sur les routes, opérations de sabotage, etc.). Ce qui vexa profondément le commandement qui ne l’admit point ainsi.
En contraste à ces attitudes isolées, la tentation fut grande cependant pour les populations de cette rive gauche du Rhin de faire scission avec le Reich, tandis que ce dernier ne l’admit point ainsi.
Le 32ème CA quitta aussi temporairement la ville pour la vallée de la Ruhr plus tard, emportant avec lui ses plus gros effectifs.
Si le PC du 32ème CA après la Première Guerre mondiale bougea beaucoup, il conserva toutefois sa base arrière dans la région de Neustadt.
La vie à Neustadt
De son côté, dès son installation provisoire terminée, en ce début d’année 1919, le commandement militaire français en ville mit en place une multitude de documents bilingues pour instaurer définitivement l’ordre dans sa zone de responsabilité. Des cartes de circulation parurent au profit de la population ou encore des bons de réquisition.
Si le bâtiment complet de la « Saalbau » fut réquisitionné par le commandement français, les militaires bons princes, dans les années qui suivirent, cédèrent progressivement aux autorités allemandes de nombreuses pièces de cette opulente bâtisse.
A partir du 7 juin 1920, il y eut une recrudescence d’attitudes belliqueuses civiles qui laissèrent entrevoir le pire. La ville vit alors arriver un renfort temporaire de 900 officiers et hommes de troupe français pour lesquels il fallut trouver, de toute urgence, un hébergement supplémentaire. Attitudes réfractaires car la population constata que les troupes françaises pillèrent littéralement le pays pour envoyer le matériel en métropole, en commençant par les systèmes d’armes abandonnés sur place par les soldats du Kaiser, mais aussi les locomotives, les camions, les métaux, le bois, etc., bref tout. En outre, toutes les occasions furent exploitées au maximum afin d’organiser de nombreuses parades militaires et montrer au peuple allemand, la supériorité nationale. Le commandement entendit ainsi démontrer sa volonté d’imposer, par la force s’il le fallut, les conditions de l’Armistice et du Traité de Versailles.
La pénurie de pain, plus exactement de farine, toucha toute la population alors que les troupes d’occupation continuèrent de leur côté à être normalement approvisionnées. Il y eut une insuffisance générale de pommes de terre et de viande. Les autorités civiles distribuèrent les denrées de première nécessité, contre remise d’un bon de rationnement. A l’approche de l’hiver le bois de chauffage fit cruellement défaut. Le charbon aussi.
Dans un élan de générosité et de compassion envers l’ennemi d’hier, le commandement français donna aux agriculteurs quelques chevaux de trait pour les aider au travail dans les champs. D’ailleurs au moment de la démobilisation des troupes allemandes, en novembre 1918, un appel fut lancé aux soldats en transit dans la ville afin qu’ils fassent don de leur cheval à la population nécessiteuse.
La censure des journaux locaux fut toujours de rigueur. Toutefois les décisions de justice du Tribunal Militaire de Landau apparurent dans la presse. Le commandement souhaita ainsi mettre en exergue les sanctions prononcées à l’égard des contrevenants allemands.
Dès le mois d’août, 230 appartements furent mis à la disposition de l’occupant. On construisit davantage pour les officiers français. Cependant la situation du côté allemand demeura tendue. Plus d’un millier de citoyens allemands chercha aussi un appartement. Cette situation laissa le commandement français indifférent.
Il y eut le cas désespéré de cet Allemand à qui la maison fut réquisitionnée. Il dut se replier dans une mansarde et mit fin à ses jours. Ainsi le déséquilibre immobilier éclata au grand jour et toutes les parties, allemande et française, prirent conscience du problème de logement. A la hâte, on éleva quelques bâtiments pour les familles allemandes, mais cela ne suffit pas.
Les troupes françaises affectionnèrent la chasse et il ne fut pas étonnant de constater que les bois autour de Neustadt virent leur cheptel sauvage disparaître au grand désarroi des gardes forestiers.
Les années allant de 1919 à 1923 furent vécues par la population comme étant les pires de cette période.
0-0-0-0-0-0-0-0-0
Constructions
Après le Traité de Versailles d’importantes et soutenues tractations eurent lieu entre les autorités militaires françaises et civiles allemandes. La presse locale se fît régulièrement l’écho des difficultés auxquelles devaient faire face les autorités de la ville pour appliquer les termes du Traité en fournissant notamment des logements aux officiers français.
Ce n’est que 3 ans plus tard, en 1922, que des plans concrets furent posés à la table des négociations pour la construction d’un casernement. La ville en fut le maître d’œuvre, au travers du Reichsneubauamt, et le confia au commandement français à l’issue des travaux.
Les travaux de terrassement et de maçonnerie débutèrent avant l’hiver.
Des appels d’offres complémentaires furent insérés dans le journal « Pfälzischer Kurier » en 1923 et les premières troupes françaises investirent ce nouveau périmètre militaire 2 ans plus tard, en 1925. On la baptisa caserne du Train.
Dans le même temps furent construits ou consolidés deux autres casernements : l’un sur la Lachenerstraße, en ville, en direction de Spire (futur quartier CONDÉ), le second à proximité du terrain d’aviation de Lachen-Speyerdorf (futur quartier EDON).
A partir de 1923, la ville entreprit aussi d’autres constructions au profit des troupes françaises. Aux côtés des casernes, des appartements pour les officiers et sous-officiers mariés et divers lieux de détente virent aussi le jour. Les appartements d’officiers, séparés des autres, étaient situés majoritairement en ville dans les rues Luitpold (Konrad Adenauer), Neumayer et Werder, à proximité de l’état-major du Corps d’Armée, mais aussi ailleurs en périphérie. Les sous-officiers, pour leur part, furent d’abord logés avec la troupe avant d’investir leurs logements, majoritairement dans les rues Landauer, Lachener et Gutleuthaus au plus près des casernements, ou plus loin en ville. La majeure partie de ces bâtiments fut réhabilitée en version civile après 1930. Construits solidement avec des pierres en grès, toutes ces maisons aux murs épais vieillirent très bien. En parcourant les rues, on peut encore deviner de nos jours ces structures d’un autre temps, parfaitement restaurées et repeintes.
La troupe, enfin, en majorité, s’installa dans des grands bâtiments en ville au début, susceptibles d’avoir une importante capacité d’hébergement comme ce bâtiment de la mairie sur la place du marché, ou au plus près de la gare et ensuite dans les casernements terminés.
Au total, le Reich construisit 94 appartements au profit des troupes d’occupation.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Rhénanie : en allemand Rheinland. Région d’Allemagne, sur le Rhin, qui s’étend de la frontière française à la frontière néerlandaise.
Commandées par l’empereur (le Kaiser) GUILLAUME II qui abdiqua et se réfugia en Hollande – la République allemande fut proclamée.
République de Weimar : régime politique de l’Allemagne de 1919 à 1933. Ville d’Allemagne située en Thuringe.
Le général MANGIN, commandant la 10ème armée française, avait hissé, le 14 décembre 1918 sur le Palais de Mayence, le drapeau français.
Ce bâtiment correspond aussi à l’ancien Bureau Postal Militaire dans les années 60. Il fut construitpar la firme Julius FILLIBECK et Fils au profit de l’état-major local de défense du Kaiser.
Important bâtiment situé en bas de la place de la gare et dès le début de l’occupation réquisitionné par les Français.